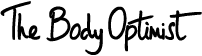Armée de ses bombes colorées, de sa créativité et de son escabeau d’acier, KashinK recouvre les murs du monde entier de fresques engagées. À travers ses graffitis aux tons vifs, la flamboyante artiste s’interroge sur les normes qui cloisonnent nos libertés. Du genre, à la beauté en passant par la féminité, elle tire un trait sur les diktats et redessine une société plus juste. Avec sa forte personnalité et son regard avisé, la quarantenaire a su s’imposer dans un milieu éminemment masculin.
Au-delà de la sphère urbaine, cette femme aux mains d’argent fait brûler la flamme de la diversité. À l’effigie de ses personnages protéiformes, elle revêt fièrement la moustache. D’un revers d’eye-liner, KashinK dessine ces petites courbes noires sous son nez pour donner de la résonance à sa lutte. Avec cette signature si singulière, elle renverse les codes esthétiques. Analyser, bouleverser, déstabiliser… par ses œuvres à ciel ouvert et sa personnalité anticonformiste, la street-artiste secoue les traditions. Rencontre.
Les bombes comme objet de lutte
Depuis 2006, Maeva alias KashinK, prend d’assaut les façades ternes de toutes les contrées. Après de longues années d’étude dans le domaine des RH, la native d’Alès est traversée par le frisson de l’aventure. Elle plaque cette vie de bureau monotone pour faire vibrer son style artistique décalé. Dès l’adolescence la graffeuse bouillonne de rage face aux injonctions dominantes et aux pensées arriérées. Très jeune, KashinK développe alors une patte qui dénote.
Aux antipodes des autres graffeuses qui signent des tags girly, ses œuvres s’esquissent comme de véritables armes de protestation. À travers le street-art, elle trouve une forme de liberté et de transgression inédite.
La tête brûlée du street-art
Son catalogue culturel fusille les innombrables clichés qui culminent encore au sommet des mentalités. Avec son audace légendaire, la forte tête s’empare de thématiques brûlantes. En 2012, face aux interventions homophobes de la Manif pour Tous, KashinK est ainsi traversée par une vague de colère. Bombes en poche, elle redore fièrement le blason arc-en-ciel en initiant le projet « 50 Cakes of Gay ». Vagabonde dans l’âme, KashinK a pu peindre près de 300 « gâteaux pour tous » en France, aux États-Unis, en Espagne ou encore en Autriche.
Ce militantisme à mi-chemin entre douceur et ardeur a fait décoller sa carrière. Le cœur sur la main, la quarantenaire collabore aussi bénévolement avec des associations telles que La Voix de l’Enfant, Emmaüs, Amnesty International ou encore Act Up. En une décennie, cette reine de la rue est devenue l’emblème moderne des droits humains. Ses portraits presque oniriques à la frontière des genres, eux, érigent le drapeau de la tolérance.
The Body Optimist : Pouvez-vous vous présenter en quelques mots ?
KashinK : « Je suis KashinK, je viens d’avoir 40 ans et je suis street-artiste à temps plein. Si je devais définir ce que je fais, je dirais que je pratique une forme d’art publique qui questionne l’identité, les normes et tout ce qui nous paraît acquis socialement. »
Dans le milieu du street-art, on vous connaît donc sous le nom de Kashink, qu’est-ce que cela signifie ?
« C’est un pseudo que j’ai repéré dans un comic books quand j’étais adolescente. En fait c’est une onomatopée comme bing, bang ou crac. Dans l’histoire, c’était le bruit de quelqu’un qui dégainait une épée, c’était une action forte. J’adorais la sonorité de KashinK. Je n’avais pas envie de prendre un nom avec le mot « miss ». À l’époque j’avais déjà conscience d’une potentielle non-binarité, donc je ne voulais pas être enfermée dans une définition un peu genrée.
En étant enfant, j’étais à la fois un garçon manqué et j’aimais bien la coquetterie. On se cherche tous à cet âge. Mais quand j’avais 10 ans, je ne trouvais pas de modèles qui me ressemblaient autour de moi. Je me sentais différente, je sortais de ces fameuses « cases », ça a toujours été compliqué pour moi de trouver ma place. J’ai mis beaucoup de temps avant de m’affranchir complètement du regard des autres. J’ai longuement réfléchi à cette manière de se présenter au monde. Finalement mon art m’a aussi permis de poser des mots sur certains aspects de ma vie personnelle. »
Justement, en quoi le street-art est-il plus puissant pour exprimer des idées ?
« Il y a deux choses. Déjà, le street-art contourne et casse tous les codes du marché de l’art en général. Il n’est pas boosté par des galeristes ou d’autres décideurs. Les street-artistes sont obligés de se faire leur propre visibilité. Par exemple, j’ai dû créer mon site personnel seule, j’ai choisi moi-même mes outils de communication sur lesquels je voulais m’exposer… Alors, parfois c’est épuisant parce qu’on doit tout gérer seule mais on jouit d’une très grande indépendance.
Le street-art est intéressant parce qu’il amène des codes disruptifs dans la rue. J’ai pu parler d’égalité des droits, des normes sociales et d’autres sujets qui me tiennent vraiment à cœur. Dans ce milieu, on est plus libre, on ose davantage. »
Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur votre parcours professionnel justement ? Comment avez-vous débuté dans le street-art ? Quel a été le déclic ?
« J’ai un master en Ressources Humaines que j’ai fait dans une école de communication qui s’appelle le CELSA. Presque toute ma famille travaille pour l’Éducation Nationale, on ne m’a donc pas trop encouragé à aller vers une carrière artistique. Mais à 17 ans, en quittant le nid familial pour vivre sur Paris, j’étais enfin libre comme l’air. Finalement, c’est à partir de ce moment-là que j’ai commencé à réaliser pleins de stickers et de tags. Au début, je ne pouvais pas en vivre. En parallèle de ce hobby, je travaillais dans les RH, j’avais un bon poste. Mais je n’ai pas tenu longtemps, cette vie standard n’était pas faite pour moi.
Mes ami·e·s m’ont ouvert les yeux et j’ai décidé de tout plaquer pour me lancer dans l’art urbain. Peindre à la bombe c’était un grand plaisir mais c’était aussi techniquement difficile. J’ai beaucoup pratiqué avant de m’affirmer. Ça fait 7 ans que je vis entièrement du street-art. 2013 a été une année charnière puisque j’ai été invité pour peindre à une foire d’art contemporain de Miami. Ça m’a ouvert plein de portes, surtout à l’international. »
À travers vos œuvres, vos personnages portent une moustache et depuis sept ans, vous en dessinez une chaque matin sur votre visage. Pourquoi cet attribut vous attire-t-il ?
« Je pense que ça me correspond bien. Quand j’ai commencé à porter ce maquillage, j’ai un peu eu une révélation. Je me suis dit « ouah ça me plaît ! ». J’ai des cheveux longs, je me dessine une moustache au eye-liner, j’ai un style vestimentaire plutôt masculin… toutes ces contradictions-là me reflètent.
Au début, la moustache me permettait d’incarner un personnage et petit à petit elle m’a permis de me révéler. Le maquillage est loin d’être un simple artifice, il peut s’avérer très puissant pour s’auto-découvrir. Quand on est une femme et qu’on se balade avec ce trait sur le visage, ça interpelle. C’est aussi ce que je voulais. Je voulais provoquer le questionnement de l’autre. »
Sur les murs du monde entier, vous dessinez des créatures protéiformes, colorées et sans genre. Pourquoi la notion d’identité vous importe-t-elle autant ? Qu’est-ce que vous souhaitez dénoncer ?
« J’ai toujours été dans la volonté de défendre les minorités ou les gens oppressés. Ça a toujours fait partie de ma vie parce que moi aussi j’ai subi des injustices et des regards méprisants. Je veux vraiment libérer les paroles, je suis peut-être un peu utopiste, mais j’aimerais que tout le monde se sente bien dans sa peau.
Souvent, on a tendance à se mettre des barrières parce qu’on craint toujours d’être jugé. Mais ça nous bloque, ça nous empêche de montrer notre vrai visage. En taguant des personnages non genrés, sans sexes, je veux éveiller les consciences. On ne devrait pas se sentir prisonnier de son corps ou de ses origines. »
Comment êtes-vous arrivée à cette signature si singulière ? Quelles valeurs revendiquez-vous à travers l’art ?
« Au début, mes dessins étaient beaucoup moins flashys et les bonhommes étaient plus humanoïdes, plus proches de la réalité. C’est curieux mais, quand j’ai commencé à peindre, je ne voulais pas dessiner des femmes. Justement parce que j’avais peur de tomber dans les codes esthétiques. On a tellement tendance à idéaliser le corps féminin que ça en devient presque caricatural. On est complètement matrixé par ces images de femmes photoshopées. Et c’est ça qui crée les complexes. Je ne pourrais pas changer ce système patriarcal cruel dès demain, par contre je peux le dénoncer. »
En 2012, vous avez frappé fort pour défendre le mariage pour tous, en imaginant une fresque intitulée « 50 cakes of gay ». Est-ce vous pouvez nous en dire plus sur ce projet ?
« On vit en France, les gens manifestent et ça fait partie de notre culture. Mais susciter une vague de haine et de négativité contre des gens qui revendiquaient simplement l’amour, c’est inadmissible. Pendant cette Manif pour Tous, les slogans étaient vraiment révoltants. Pour moi c’était incompatible avec notre époque moderne. Je me suis dit « Comment c’est possible qu’au 21ème siècle et dans le pays des Lumière on se retrouve encore avec des individus aussi conservateurs ? ». Ça m’a vraiment mis dans une rage incroyable. Ça m’a touché personnellement et ça m’a cassé en deux de voir ces comportements intolérants.
Pour exprimer mon soutien envers la communauté LGBT et contraster ce climat anxiogène, j’ai alors réalisé une fresque géante sur un mur parisien de façon totalement improvisée. J’ai dessiné deux personnages devant un gâteau de mariage et c’est devenu un vrai projet politique. En plus en 2012, j’ai eu l’occasion de reproduire cette œuvre partout dans le monde et j’ai eu énormément de retours positifs. »
En 2015, vous avez participé au projet « Rosa Parks fait le mur », une fresque street art de 400 mètres de long avec 3 autres femmes artistes, Bastardilla, Katjastroph, Tatyana Fazlalizade. Selon vous, est-ce que les femmes ont gagné en visibilité dans le street-art ?
« Il y a un vrai plafond de verre dans ce milieu. Moi je n’ai pas accès aux positions de pouvoir parce que je martyrise un peu les traditions. Et, on a dépossédé le street-art de sa valeur politique. Il y a encore une surreprésentation de corps féminin hyper sexualisés. Banksy ou Obey en ont un peu fait leur marque de fabrique d’ailleurs. Et tristement, ce sont ces œuvres-là qui partent à des milliards d’euros aux enchères. Mais ils n’abordent jamais la diversité, ils se concentrent uniquement sur la beauté.
Les bourrelets, les poils, les vergetures, les boutons… toutes ces petites touches d’authenticité sont absentes et ça m’accable. Les femmes street-artistes en France se comptent presque sur les doigts des mains. Je pense qu’on redoute les obstacles, on y va à tatillon parce qu’on a peur de ne pas plaire aux autres. Pour se lancer, il faut apprendre à se détacher des critiques négatives. »
D’ailleurs, comment avez-vous réussi à vous faire une place dans ce milieu urbain éminemment masculin ?
« Je n’ai jamais eu affaire à des comportements hyper misogynes, par contre je me suis fait draguer plusieurs fois. Mais dans l’ensemble les graffeurs que j’ai croisé ne m’ont jamais dénigré, ils étaient assez bienveillants, contrairement à ce que l’on pourrait croire. Ils n’ont pas remis en question ma capacité à peindre.
Dans cet art urbain, il y a une curiosité en ébullition. Dès qu’une nouvelle personne débarque, on ne va pas la mépriser, on va plutôt s’intéresser à ce qu’elle propose. À mes débuts, j’avais déjà un style très marqué et atypique, je pense que ça m’a bien aidé. Mais une femme doit se battre deux fois plus pour s’imposer. »
Ces derniers temps, on a beaucoup entendu parler du harcèlement de rue. Est-ce que vous aussi vous avez été confronté à ce phénomène ?
« Comme j’ai une certaine prestance, que je porte une moustache et que j’ai une démarche un peu « virile », je pense que ça coupe l’élan des agresseurs. Malgré ça, il y encore des hommes qui me demandent mon 06, rien de bien méchant. Mais depuis que je dessine mes traits d’eye-liner en-dessous de mes lèvres, j’ai dix fois moins de demandes. »
Si vous deviez évoquer l’un de vos meilleurs souvenirs sur le terrain ? Et le pire ?
« En meilleur souvenir, je dirais que c’était l’expo à Miami. En plus, elle était organisée par l’ancien directeur du musée d’art contemporain de Los Angeles. Il était assez avant-gardiste puisque cet événement valorisait uniquement les femmes. J’étais flattée de recevoir cette invitation. C’était assez dingue. Ça m’a permis de rencontrer du beau monde. J’ai échangé avec des street-artistes très inspirantes comme Lady Pink, la première graffeuse de New York ou Martha Cooper, une photographe de référence.
Le pire moment, je dirais que c’était en Serbie. J’ai commencé à taguer un mur, et finalement il s’est avéré que je n’avais pas l’autorisation. Avec mon équipe, on s’est fait agressé par un local très remonté contre nous. Il s’est pointé avec ses amis et des gros chiens enragés. J’avoue que j’en menais pas large. »
Comment ça se passe quand vous taguez les murs justement ? Quels risques, quelles difficultés ? À quoi ressemble une journée type pour vous?
« Quand le confinement est arrivé, j’étais presque soulagée parce que mon corps ne tenait plus. C’est une pratique artistique très physique et on s’épuise vite. Déjà, il faut toujours être vigilant pour ne pas se faire voler et en plus on porte du matériel parfois très lourd. Monter et descendre des échelles 54 fois dans la journée, apprivoiser une grande surface murale, c’est usant.
Pour la journée type, en général, je me réveille aux aurores, je bois mon café, je pars avec mon échelle et mes bombes. Sur place, parfois il m’arrive de ne pas manger, tellement je suis absorbée par ce que je fais. C’est très intense, je me contorsionne dans tous les sens, j’inhale des substances pas forcément très saines, je continue mes dessins la nuit avec des lampes torches… Mais c’est cette adrénaline qui m’anime. »
Vous parliez du confinement, comment l’avez-vous vécu en tant que graffeuse ? Avez-vous essayé de vous réinventer ?
« J’ai commencé à faire des courts-métrages dans lesquels j’imagine ce que ma vie aurait été sans le street-art. J’ai fait pas mal de lives sur Insta de musique expérimentale, je me suis essayée à la peinture d’intérieur aussi et j’ai fait davantage d’œuvres dans mon atelier. Mais cette période a remis en question toutes mes habitudes et ça n’a pas forcément été simple ».
Pour terminer, avez-vous des projets dans les mois à venir ?
« Depuis trois ans, j’écris un livre sur cette moustache qui intrigue tant. C’est un peu un journal intime, un manifeste, enfin c’est un cocktail improbable. Je raconte les anecdotes que je vis. Je voulais développer un argumentaire pour être comprise de tou·te·s. J’aimerais bien le sortir en fin d’année ».
Merci à KashinK, street-artiste pleine de pep’s, d’avoir répondu à nos questions ! Vous pouvez suivre ses aventures au-delà de notre article, sur son compte Instagram : KashinK. Mais aussi sur son site et pour acheter ses oeuvres, ça se passe ici.