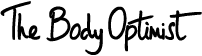Égalité et inclusion sont des termes que l’on entend beaucoup à l’heure actuelle, notamment en matière d’égalité homme-femme dans le milieu professionnel. Des mots que l’on entendrait trop ? C’est ce que semblent dire des dirigeant.e.s d’entreprise. Iels mettent en avant leur lassitude et leur peur d’être accusé.e.s de faire de la « discrimination positive », au bénéfice des femmes et de finalement desservir la cause. Focus sur le terme de « gender fatigue » et ce que cela révèle de notre société…
La « gender fatigue » ou la lassitude face à la lutte pour l’égalité home-femme dans le monde du travail
La « gender fatigue » est concept apparu en 2009 sous la plume d’Élisabeth Kelan, professeure à l’université de Cranfield, experte en leadership. Elle la définit comme :
« un phénomène par lequel s’épuise l’énergie d’agir pour faire du lieu de travail un espace neutre, alors même que les discriminations ont encore cours »
Ce que la professeure Kelan met en exergue, c’est une lassitude généralisée, que ce soit du côté des femmes ou des hommes, sur le plan de leur égalité dans le monde du travail. Du côté des dirigeant.e.s, c’est la lassitude des mesures à mettre en place qui ressort. On note aussi la peur d’être accusé.e.s de faire de la « discrimination positive » par les salariés masculins.
Une légifération prolifique rarement suivie d’actes
Le sujet de l’égalité des genres en milieu professionnel est récurrent législativement parlant. Apparu de manière officielle en 1946 en étant inscrit dans la Constitution, il est régulièrement l’objet de lois visant à le faire appliquer; allant jusqu’à devoir prévoir des contraintes financières pour les contrevenant.e.s.
La dernière loi date de 2021. Elle prévoit des quotas pour que les femmes puissent accéder à la tête des grosses entreprises. Sauf que certain.e.s dirigeant.e.s se sentent alors face à la peur d’être « obligé.e.s de devoir nommer une femme incompétente aux instances décisionnaires ». Alors que l’ambition de base du législateur était de permettre aux femmes compétentes de pouvoir accéder aux instances dirigeantes.
« Trop d’actions » pour « pas assez de résultats »
Ce qui est constaté, et qui nourrit ce sentiment de lassitude, c’est la multiplication des actions. Notamment via les lois, les médias, les réseaux sociaux beaucoup également. Finalement, le sujet est soulevé ou abordé quasi quotidiennement… sur le papier.
Dans les faits, les résultats sont bien loin de la réalité. Les progrès réels sont trop lents. Pourtant, du côté des hommes non visés directement, mais tiers concerné, le sujet est omniprésent. Et ils ont le sentiment que si des lois sont rédigées, qu’on en parle dans les médias ainsi que dans leur entreprise, l’égalité est atteinte et ne comprennent donc pas que l’on en parle encore.
Les femmes quant à elle, se heurtent à une absence d’évolution réelle de leur statut ou de leur position. Elles finissent alors par abandonner leurs désirs d’évolution. Ou les femmes n’osent pas demander pour ne pas passer pour « celle qui demande encore ».
Les conséquences néfastes de la « gender fatigue »
La lassitude et la résignation éprouvées conduisent malheureusement à un désengagement et un désintérêt pour le sujet de l’égalité homme-femme au travail. Chacun.e fait alors comme iel peut, individuellement, à son niveau, « puisque rien ne bouge malgré les lois, malgré les sanctions prévues ». Cela pousse à des réflexes individualistes.
En parallèle, c’est le retour du déni de discrimination. Tout comme le syndrome de l’imposteur et les critères de mérite qui refont surface. Il est alors par exemple justifié de ne pas octroyer d’augmentation ou de promotion à une femme, au motif qu’elle « n’était pas là pendant 2 mois et n’a donc pas fait son chiffre ».
Le sexisme bienveillant (attribuer aux femmes les postes correspondant aux seules qualités que l’on vante dans les médias) a de beaux jours devant lui, si l’on ne prend pas en compte les problématiques de fond. Plutôt que de légiférer à foison, ne serait-il pas bon et opportun de s’attaquer directement à la source ? Notamment sur les stéréotypes et les mentalités sexistes d’un point de vue global.